|

|

|
Rapport des Activités
Travail réalisé par les chercheurs de CREDDA et Heal Africa
Etude d’impact du projet genre et justice/Heal Africa et d’indentification des obstacles socioculturels qui bloquent l’accès à la justice des survivants des violences sexuelles.
Etude réalisée conjointement par HEAL Africa et CREDDA/ULPGL
Sous la Direction du Prof. Dr. Kennedy KIHANGI BINDU, LLD
Disponible sur :
http://www.congonova.org/revue/index.php?option=com_content&view=article&id=391:etude-dimpact-du-projet-genre-et-justiceheal-africa-et-dindentification-des-obstacles-socioculturels-qui-bloquent-lacces-a-la-justice-des-survivants-des-violences-sexuelles&catid=55:articles-numero-19&Itemid=170
Ensemble nous garderons très haut le drapeau de la recherche en Afrique
Recherche - Action / Evaluation du Projet Genre et Justice - Heal Africa en Province du Nord - KIvu en République Démocratique du Congo
Depuis Novembre 2011, le Centre de Recherche sur la Démocratie et le Développement en Afrique, CREDDA, a été sollicité par l'ONG Heal Africa pour procéder à l'évaluation de son projet Genre et Justice sur l'accompagnement judiciaire et juridique des survivantes des violences sexuelles. Les chercheurs de CREDDA sont sur le terrain depuis deja quelques mois et vont présenter les résultats de leurs travaux ce Mardi 10 avril 2012. Au cours de cette séance de restitution, les partenaires à Heal Africa auront l'occasion d'échanger avec l'équipe des chercheurs CREDDA/Faculté de Droit de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs, ULPGL. Après débats et analyse des suggestions de l'audience, le rapport sera publié en ligne par CREDDA/ULPGL et Heal Africa.
Ce travail scientifique (recherche - action) vous fournit des données de terrain fiables et vérifiables sur la question des actions entreprises dans la lutte contre les violences sexuelles au Nord Kivu et les recommandations formulées à l'endroit des différents acteurs impliqués dans cette thématique. Prière de lire ce rapport au travers de ce site dans quelques jours.
Ensemble nous garderons très haut le drapeau de la recherche en Afrique.
Prof Dr Kennedy KIHANGI BINDU
Coordinateur CREDDA/Faculté de Droit
Université Libre des Pays des Grands Lacs
JOURNEES SCIENTIFIQUES ORGANISEES PAR L’UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS AVEC LA PARTICIPATION DES CHEURCHEURS DU CENTRE DE RECHERCHE SUR LA DEMOCRATIE ET LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE, CREDDA
Thème : L’EXPLOITATION DU PETROLE DU LAC EDOUARD ET LES IMPERATIFS ENVIRONNEMENTAUX
Fidèle à sa mission de former et d’informer la crème intellectuelle ainsi que les autres différentes couches de la société, le Centre de Recherche sur la Démocratie et le Développement en Afrique, CREDDA en sigle, a activement pris part, au travers de ses chercheurs, aux journées scientifiques organisées par l’Université Libre des Pays des Grands Lacs, ULPGL en sigle. Cette session a été organisée dans un contexte de mutation socio - politique en République Démocratique du Congo et la particularité de la Province du Nord Kivu qui est celle d’une insécurité généralisée. Les institutions précitées n’ont pas voulu entretenir un silence coupable face aux enjeux économiques et environnementaux liés à la grande question de l’heure notamment l’exploitation du pétrole du Lac Edouard par l’entreprise SYDNEY OIL COMPANY (SOCO). D’aucuns s’intéressent à cette question qui suscite de grandes inquiétudes des uns et des autres s’agissant de ce projet qui aura, certes, des effets sur l’environnement, quand bien même l’Etat Congolais le considère comme un plus pour son économie. Les écologistes, contrairement aux économistes qui ne voient que les retombées économiques de l’exploitation du pétrole, sont déterminés à lutter pour la conservation et la protection de l’environnement pour assurer un développement durable de la province du Nord Kivu. Ils trouvent ainsi aberrant la matérialisation du dit projet.
L’exploitation du pétrole dans le lac Edouard, projet qui est en voie d’être matérialisé, demeure une réalité qui doit interpeller plus d’un observateur averti. Soucieux et curieux de savoir le sort réservé à l’environnement en risque de destruction lors du démarrage effectif des activités par l’ entreprise SOCO, la crème intellectuelle de l’ULPGL, CREDDA, ICCN, députés provinciaux et autres représentants de la sociétés civiles ont répondu favorablement à ce rendez vous scientifique.
En partant du thème central intitulé "L’exploitation du pétrole du Lac Edouard et ses impératifs environnementaux"; sept sous thèmes ont été développés au cours de deux journées scientifiques en date du 23 au 24 juin 2011, à savoir :
- L’Etat des lieux de l’exploitation du
pétrole du lac Edouard
- L’exploitation du pétrole et la loi
environnementale en République
Démocratique du Congo
- De l’exploitation du pétrole dans un site
du patrimoine commun de l’humanité : une
lecture d’un acteur de protection
- Les technologies d’extraction, de
transformation et de transport du pétrole
dans les limites de l’éthique
- Les traumatismes générés par les menaces
d’exploitation du milieu de vie des
populations
- Les retombées économiques de
l’exploitation du pétrole – PIB
- L’exploitation pétrolière et ses effets
sur la santé.
Au moment où le Parc National des Virunga, une grande réserve touristique reconnue comme un site du patrimoine commun de l’humanité, les raisons économiques évoquées par le gouvernement Congolais semblent l’emporter sur la conservation et la protection de l’environnement combien aussi bénéfique pour la vie humaine. L’Ordonnance Présidentielle N° 10/044 du 18 Juin 2010 portant approbation du Contrat de Partage de Production conclu le 5 Décembre 2007 entre la République Démocratique du Congo et l’Association Dominion Petroleum Congo, SOCO Exploration – Production RDC et La Congolaise des Hydrocarbures (COHYDRO) sur le Bloc V du Graben Albertine de la République Démocratique du Congo est à exécuter malgré les effets néfastes de l’exploitation sur l’environnement. Cette exécution exigerait aussi le déplacement de certaines populations du site d’exploitation en laissant derrière elles champs, habitations, élevages, et d’autres biens de valeur.
Après les mots d’ouverture, la présentation des objectifs et programme des journées scientifiques, les sous thèmes ont été abordés de la manière ci-après :
1. Etat des lieux de l’exploitation du pétrole
du Lac Edouard
Par l’honorable député NZANGI BUTONDO
Bien informé sur la question de l’exploitation du pétrole du Lac Edouard et ayant participé à plusieurs descentes sur le terrain, Parc Nation des Virunga et Lac Edouard, avec les représentants de l’entreprise SOCO pour la sensibilisation de la population riveraine, l’honorable NZANGI n’a pas hésité de donner certains éclaircissements mais aussi sa position à l’auditoire par rapport au projet d’exploitation du pétrole par SOCO.
L’occasion faisant le larron, l’honorable a fait voir la nécessité pour la RDC à exploiter le pétrole, l’une des ressources naturelles que Dieu a donné au peuple Congolais. Par là, il a démontré noir sur blanc que le Congo, à lui seul, gère 73 pourcent du Lac Edouard qui fait partie du Parc National des Virunga exploité par les populations riveraines. Les 27 pourcent restants sont gérés par l’Ouganda, et ne font pas partie du Queen Elizabeth Park en Ouganda. C’est dans cette partie que l’entreprise DOMINION est en train d’exploiter le pétrole, du coté Ouganda.
En République Démocratique du Congo (RDC), par contre, l’exploitation du pétrole traine suite aux obstacles causés par plusieurs intervenants notamment l’UNESCO chargé de la gestion du Parc National des Virunga, site du patrimoine commun de l’humanité ; l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature – ICCN, la société civile du Nord Kivu en matière environnementale et la population. La bande contenant une importante quantité du pétrole au Nord Kivu/RDC s’étend sur trois territoires dont RUTSHURU, LUBERO et BENI. Rien donc ne sert de croiser les bras devant cet or noir tant recherché dans le monde entier. Il y a risque que le Congo perd tout en laissant l’Ouganda seul s’investir dans l’exploitation du pétrole. Pendant que la RDC sera dans des polémiques stériles, il ya risque que l’Ouganda exploite aussi le pétrole du coté Congolais à partir des puits installés en Ouganda. C’est cela qui motive l’honorable NZANGI BUTONDO à soutenir l’exploitation du pétrole du Lac Edouard par SOCO contrairement aux écologistes qui désapprouvent ce projet par souci de préservation de l’environnement. Il estime que grâce à cette activité, les populations locales auront, sans doute, à bénéficier des différents projets de développement qui seront financé par SOCO tels que l’électrification des villages, construction des écoles, adduction d’eau potable, aménagement des routes de desserte agricole, ….Il note également que la même activité d’exploitation du pétrole serait un plus à l’économie du pays et au profit de toute la nation Congolaise. C’est pourquoi, il trouve aberrant et/ou illogique que le peuple croupisse dans la misère en train de contempler des grandes richesses naturelles qui peuvent favoriser son développement. Tout en reconnaissant le rôle ainsi que l’importance de l’environnement dans la vie de l’homme, ce dernier estime que l’important serait pour les hommes qui sont au centre de toute activité de trouver un terrain d’entente entre l’intérêt économique que va générer l’exploitation du pétrole et la protection du Parc en particulier et l’environnement en général. Si les deux sont bien gérés, le social de la population va connaitre une amélioration.
2. L’exploitation du pétrole et la loi
environnementale en République
Démocratique du Congo
Par Dr KIHANGI BINDU Kennedy
Abordant son thème, le Dr KIHANGI BINDU Kennedy n’est pas passé par quatre chemins en démontrant que le droit est indissociable de la protection de l’environnement, parce qu’il est étroitement lié à toute forme de protection. Il ne peut y avoir de protection ou prévention sans interdiction ou plus largement, sans prescription (prohibition) des comportements. C'est-à-dire que la protection de l’environnement passe par l’édiction des normes (conventions internationales, lois et règlements, …).Nul ne s’abstiendrait par exemple de l’étude d’impact d’un projet sur l’environnement si une arme juridique ne la rendait obligatoire. Or, qui dit exploitation du pétrole dit ipso facto destruction de l’environnement ou de l’écosystème avec un effet négatif sur les vies humaines. Pour bien illustré cette vérité, il n’a pas manqué d’évoquer l’exemple incontestable du Nigeria, et même, de Moanda au Bas Congo/RDC (Firme PERENCO). Suite à l’exploitation du pétrole, on a enregistré des pollutions chimiques des eaux, de l’air, … qui causent plusieurs maladies au sein des populations riveraines de sites.
Pour le Dr KIHANGI BINDU Kennedy l’intérêt pour la population dans le projet d’exploitation du pétrole dépendrait de la gouvernance du pays parce qu’il est question de tenir compte des intérêts des générations présentes et futures par rapport à l’exploitation de cette ressource naturelle non renouvelable. Interrogeant le cadre Constitutionnel et législatif du pays, il a démonté la souveraineté de l’Etat sur ses ressources naturelles mais aussi sa responsabilité pour une conservation de l’environnement et un partage équitable des revenus issus d’une éventuelle exploitation. Les articles 9, 53, 54, 55, 56, 57 58 et 59 de la Constitution du 18 Février 2006 de la RDC évoquent plus la souveraineté de l’Etat Congolais sur ses ressources naturelles, le droit à l’environnement reconnu au peuple Congolais et plus particulièrement le droit reconnu aux Congolais de jouir du patrimoine commun de l’humanité.
Il a aussi rappelé l’importance de la conduite d’une étude préalable d’impact environnemental et social exigée par le Code Forestier à son article 19 et le Code Minier à son article 15. Par cette procédure, la population pourra donc participer et se prononcer sur le projet à exécuter et présenter son cahier des charges. La procédure d’étude d’impact environnemental et social demeure d’une importance certaine pour non seulement la population locale, la protection de l’environnement mais aussi l’entreprise d’exploitation qui bénéficiera du soutient de toute la population. Il s’agit d’une étape majeure d’appropriation par la population du projet et de confiance mutuelle entre elle et l’entreprise. Pour le Dr KIHANGI BINDU Kennedy, le projet demeure très alléchant mais avec des conséquences environnementales fâcheuses non négligeables. Le balancing on interests demeure la seule clé de voûte à ce propos.L’entreprise qui exploite le pétrole est dans l’obligation d’observer les normes juridiques environnementales pour une protection efficace de l’environnement. Tout cas de débordement lors de l’exploitation engagerait la responsabilité tant civile que pénale de l’entreprise. Le souci de l’Etat est de vouloir limiter les éventuels dérapages de toute exploitation anarchique à laquelle se livrerait l’entreprise en se lançant dans la destruction de l’écosystème.
3. De l’exploitation du pétrole dans un site
du patrimoine commun de l’humanité : une
lecture d’un acteur de protection
Par Joel WENGAMULAY
Acteur de protection du Parc National des Virunga, il a, pour mieux éclairer l’opinion sur la question du site du patrimoine commun de l’humanité, commencé par présenter les missions de son institution, l’ICCN. Il s’agit notamment de rétablir un Etat de droit dans les aires protégées ; et valoriser les ressources naturelles des aires protégées pour les populations locales, nationales et internationales.
En tant qu’agent de l’ICCN, l’orateur a profité de l’occasion pour démontrer combien le Parc National des Virunga riche en espèces animales rares comme le Gorille et autres, est en train de recouvrir petit à petit son image datant grâce aux résultats des sensibilisations des populations riveraines pour leur implication dans la protection de cette réserve naturelle bénéfique à toute l’humanité, plus particulièrement à la nation Congolaise. Cela avec le concours, bien entendu, de certains partenaires de l’Union Européenne qui ont disponibilisé des fonds importants pour que une telle activité soit possible.
Il a montré que grâce à l’intervention de partenaires pour le rétablissement d’un Etat de droit dans les aires protégées, un nombre assez important des gardes parc bien équipés et encadrés est mobilisé afin de veiller jour et nuit à la protection du Parc National des Virunga inscrit à l’UNESCO comme un bien du patrimoine commun de l’humanité ; quand bien même certaines bandes armées constituées des FDLR, Interhamwe et citoyens Congolais animés de mauvaise foi tentent de décourager les bonnes initiatives en s’attaquant aux gardes parc mais aussi en abattant les bêtes sauvages.
Dans le cadre de la valorisation des ressources naturelles des aires protégées comme c’est le cas du Parc National des Virunga, aujourd’hui les populations riveraines sont en train de bénéficier des différents projets initiés et réalisés par l’ICCN grâce au concours infatigable des partenaires extérieurs.
Environnementaliste de son état et soucieux à la fois de la croissance économique du pays, Mr Joel WENGAMULAY avant de finir son exposé, a reconnu toutefois la souveraineté de l’Eta Congolais sur ses ressources naturelles (sol et sous sol) et donc libre de décider sur la gestion de ces dernières. Cependant, ce qui serait le plus essentiel pour l’Etat Congolais serait d’expliquer clairement à la nation pourquoi le choix de l’un ou de l’autre projet afin de lever toute équivoque sur la question. Donc, l’Etat doit soit accepter d’exploiter le pétrole au détriment du parc, site touristique et faisant partie du patrimoine commun de l’humanité, soit on conserve et protège l’environnement vu sur le Parc National des Virunga et ne plus exploiter le pétrole pour bénéficier des avantages que procure le tourisme.
4. Les technologies d’extraction, de
transformation et de transport du pétrole
dans les limites de l’éthique
Par l’Ir Olivier BARAKA MUSHAGE
L’activité d’extraction, de transformation et du transport du pétrole mérite une attention particulière de tout un chacun vu le danger qu’elle présente pour l’environnement et pour la vie humaine. C’est pourquoi, il s’avère très indispensable pour le gouvernement qui octroie le marché et pour l’entreprise qui exploite le pétrole de pouvoir trouver un terrain d’entente avant le démarrage des activités et fixer de techniques de forage qui seront utilisées dans le souci de vouloir minimiser les risques de destruction de l’environnement.
L’exposé étant purement technique, l’Ir Olivier BARAKA M. est passé à l’explication du processus d’extraction du pétrole comme première phase de l’activité, de la deuxième phase qui consiste à la transformation des matières brutes puisées dans le sol et enfin du transport du produit déjà traité ou raffiné. Parlant de la transformation des matières brutes en vue d’obtenir le pétrole comme produit fini et ses dérivés, il a fait savoir que cette étape est à l’origine de la pollution de l’air suite aux fumées que fait ressortir les machines ou usines utilisées pour cette fin et on ne peut pas s’en passer. On peut donc dire qu’à ce niveau là, la fumée est inévitable d’autant plus que c’est l’opération elle-même qui l’exige et qui parle de la transformation du pétrole parle d’office de la fumée, un danger pour les vies humaines.
En ce qui concerne le transport du pétrole, celui-ci s’effectue souvent à travers les camions citernes, les pipelines, etc. et présente également des dangers pour l’homme et l’environnement dans le cas où il y aurait tout accident suivi d’un contact de feu. Et là on va sans doute vivre une catastrophe avec des graves incendies, des pertes en vies humaines … ce qui est plus recommandé ici est de prendre toutes les précautions possibles de sécurisation de toutes ces voies (possibles) appropriées pour le transport du pétrole car dit-on, mieux vaux prévenir que guérir.
Au sujet des technologies utilisées dans l’extraction du pétrole, l’Ingénieur BARAKA a , étant bien informé en la matière, il a mis un accent particulier sur les techniques des forages horizontaux parce que selon lui elles demeurent les seules qui permettent d’extraire le pétrole sans causer beaucoup de dégâts à l’environnement censé être protégé par tous. En définitive, il est tout à fait impossible de parler du projet de l’exploitation du pétrole quelles que soient les techniques utilisées sans parler de la destruction de l’environnement d’une manière ou d’une autre. C’est au fait une question d’appréciation du degré de destruction qui doit faire objet d’une étude par les parties concernées.
Plusieurs autres exposés ont suivi avant la clôture des travaux. Des recommandations constructives ont été formulées en carrefour avant leur discussion en plénière. Des recommandations ont été formulées à l’endroit du gouvernement Congolais, de la population ainsi qu’à l’entreprise SOCO.
Fait à Goma, le 28 juin 2011
Le Secrétaire de CREDDA
Obed MBUSA MULEMBERI
Conférences
Le maintien ou la levée de la mesure prise par le Président de la République portant suspension de l’exploitation de minerais au Kivu
Contexte et justification
Vu la situation socio-économique et politique qui prévaut depuis plus d’une décennie à l’Est de la RDC, et particulièrement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, qui est celle des guerres successives et persistantes entre différents belligérants ; il est impérieux de faire remarquer, comme les communs des mortels sont sans l’ ignorer, que les populations civiles constituent la couche sociale la plus sensiblement affectée et touchée par les retombées et les effets macabres de toutes ces guerres. C’est ainsi que le CREDDA n’est pas resté terne, il a jugé bon de contribuer, tant soit peu et dans la mesure du possible à la réduction de la vulnérabilité des populations frappées par ces conflits armés.
En effet, la dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays continuant à battre record malgré la déclaration officielle de la fin des hostilités par le Président de la République, et cela continue à affecter négativement la situation humanitaire dont les victimes les plus vulnérables demeurent hommes ; femmes et enfants.
Aussi, à ces grandes vagues de déplacements internes des populations durant la deuxième moitié de l’année 2008, se sont ajoutés des milliers des nouveaux déplacés surtout depuis le début du mois de Septembre. Cela n’a pas suffit, l’exploitation illicite des minerais par les groupes armés et autres, les viols et violences sexuelles systématiques, le pillage des ressources naturelles au profit des inconnus, le trafic des armes légères,…
C’est dans le but noble d’apporter une contribution, par le biais des recherches et des conférences-débats en connivence avec ses partenaires et collaborateurs, que le CREDDA a préconisé organiser avec BEDEWA, une conférence-débat à l’attention des étudiants, enseignants et personnel de l’ULPGL Goma, sur le thème : « Le maintien ou la levée de la mesure prise par le Président de la République portant suspension de l’exploitation de minerais au Kivu ».
Raison pour laquelle il a ciblé aussi à cet effet, d’autres acteurs sociaux de la communauté locale de Walikale en particulier, car une fois conscientisés, ils pourront participer de façon bénéfique aux recherches pour la démocratie et le développement avec lui afin de relever les défis ensemble et d’aider ces milliers d’innocents touchés par ce drame social tragique et qui restent ignorants. Cette dernière démarche permet au CREDDA de concrétiser l’une de ses aspirations par l’approche de participation communautaire.
Activités réalisées
Les activités réalisées par CREDDA/ Asbl/Ongd au cours de cette conférence sous examen, dans le cadre de ses objectifs précités et ce en collaboration avec BEDEWA et ULPGL, se résument de façon succincte et sommaire dans le récit narratif ci dessous :
CONFERENCE - DEBAT DE CE VENDREDI, LE 29/10/2010
Organisations initiatrices : CREDDA, BEDEWA (Bureau d’Etude pour le Développement de Walikale) et ULPGL Goma
Lieu : ULPGL Goma, Campus Salomon, Grande salle de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Nombre de participants : 75 personnes
Cibles : Enseignants, étudiants et personnel de l’ULPGL Goma
Heure : De 12h50 à 14h25
Modérateur : Mr Pierre MAZAMBI, Assistant à Faculté de Droit de l’ULPGL Goma
Orateurs : - Mr Prince KIHANGI, Secrétaire Exécutif de BEDEWA et Juriste indépendant
- Docteur Kennedy KIHANGI BINDU.
Déroulement :
-12H 50’ : Hymne national
-12h55 : Présentation du CREDDA, par le Docteur Kennedy KIHANGI BINDU
Le contenu de son allocution est repris en intégralité dans la séquence suivante :
Mot de circonstance prononcé par le Coordinateur du Centre de Recherche sur la Démocratie et le Développement en Afrique, CREDDA en sigle
Kihangi Bindu Kennedy
Docteur en Droit
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
C’est pour moi un honneur et un plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce magnifique cadre de réflexion de notre Alma Mater l’Université Libre des Pays des Grands Lacs, ULPGL en sigle. Il s’agit bien entendu d’un rendez vous scientifique de donner et de recevoir en éclairant la lanterne des uns et des autres.
Fidèle à sa mission d’éveiller la conscience de l’universitaire et du citoyen sur ses responsabilités dans la gestion de la chose publique, du développement humain et socio –politique de la société, CREDDA offre une fois de plus une occasion aux chercheurs, à la crème intellectuelle, aux acteurs politiques ainsi qu’aux communautés locales de s’édifier mutuellement en s’interrogeant sur « le maintien ou la levée de la mesure prise par le Président de la République portant suspension de l’exploitation de minerais au Kivu ».
Certes, il s’agit d’une question de haute facture qui a des implications socio – politiques mais aussi économiques avec des effets collatéraux dans plusieurs autres secteurs de la vie. D’aucuns s’interrogent sur l’opportunité de son maintien ou de sa levée. Mais que pense la crème intellectuel qui est considérée comme étant le phare des générations présente et futures. CREDDA estime qu’il doit prendre ses responsabilités en mains en mettant à la disposition de la société son savoir. Cela est d’autant plus indispensable car « la science permet de vaincre l’ignorance, la pauvreté et la violence qui détruisent notre société. La démarche scientifique en Afrique aussi doit être considérée comme un outil performant, une force à promouvoir au service de l’humanité ».
En effet, cette conférence s’inscrit dans les cadres de recherches que CREDDA est en train de mener sur la gestion des ressources naturelles au Nord – Kivu et ses implications sur l’environnement minier (Etudes d’impact environnemental), les droits des communautés locales, le développement durable de la province, la paix et la sécurité au Kivu en particulier et la région des grands lacs Africains en général.
Il échet ici de noter que depuis plus de deux décennies, la République Démocratique du Congo, dans sa partie Est, est en proie à des situations d’instabilités socio politiques. Des motifs des acteurs engagés dans la crise pour la course au pouvoir politique demeurent de plusieurs ordres. Certains, si pas tous, s’engagent pour satisfaire leurs agendas qui peuvent avoir des buts identitaires, politiques ou tout simplement économiques. Ces intentions créent un climat des frustrations entre les différentes couches de la population et sont à l’origine de l’instabilité sus évoquée. Dans un tel contexte d’imbroglio socio – politique généralisée, l’Etat Congolais fait face à une crise de restauration de son autorité sur l’ensemble du territoire national et perd ipso facto tout contrôle sur la gestion de ses ressources naturelles dans cette partie de la République.
Depuis la rupture des relations entre les pays engagés dans la guerre dite de « libération » conduite par l’AFDL, la gestion des ressources naturelles se situant aux frontières communes des Etats pose de sérieux problèmes débouchant à la militarisation et multiplicités des milices armées dans la région. Une attention particulière est à accorder aux effets de l’exploitation pétrolière du lac Albert se situant aux frontières entre la RDC et l’Ouganda par rapport à la problématique de la paix. Mais aussi le Gaz Méthane se trouvant dans le Lac Kivu qui sépare la République Démocratique du Congo et la République du Rwanda. Le conflit et la militarisation de la région seront appréciés par rapport aux mécanismes communs de gestion et d’exploitation mis en place par les pays concernés. Une deuxième attention particulière devra être accordée aux mécanismes d’exploitation des ressources minières se situant à Walikale (Nord Kivu – Site minier de Bisie) par rapport à la présence avérée des éventuels groupes armés opérant dans la région (Interhamwe et FDLR).
Ce tableau désastreux mérite d’attirer l’attention de la communauté internationale pour un lendemain meilleur de la population de cette partie de la République. Il est un fait bien connu que les ressources naturelles ne doivent pas constituer un canal potentiel de la misère, de la pauvreté et de la malédiction mais plutôt une opportunité de développement durable. L’exploitation de ces ressources naturelles doit être considérée comme un outil de transformation des conflits, un moteur de réconciliation et de développement durable dans une région qui a longuement expérimentée les affres de la guerre en l’occurrence la Région des Grands Lacs Africains.
C’est dans cette optique que CREDDA a voulu faire bénéficié à cette auguste assemblée les résultats des journées minières organisées par la Communauté de Walikale, au travers de sa structure, à savoir le « Bureau d’Etudes, d’Observation et de Coordination pour le Développement du Territoire de Walikale, BEDEWA en sigle. Ces journées peuvent être interprétées comme une réponse à la question sus évoquée sous la formulation d’un thème d’une conférence : « Quid du maintien ou de la levée de la mesure prise par le Président de la République portant suspension de l’exploitation minière au Kivu : la Communauté de Walikale se prononce ». Il s’agit donc d’échanger, de débattre et d’enrichir les différentes recommandations formulées au cours de ces journées minières.
CREDDA est un cadre de réflexion qui est en train de poser ses pas dans une dynamique d’une Recherche – Action prônée par la Faculté de Droit de l’ULPGL. Certes, CREDDA a toujours besoin de la participation de toute personne qui aimerait apporter son savoir, son savoir – faire ainsi que son savoir être à cette grande entreprise intellectuelle. D’aucuns notent que la cloche de la tradition orale accompagnée de celle qui est écrite a sonné pour que les sociétés Africaines soient dignement positionnées dans le concert des Nations modernes.
Ensemble nous garderons très haut le drapeau de la recherche sur le continent.
L'allocution de l'orateur principal de BEDEWA est disponible au bureau de CREDDA. Prière de nous contacter aux adresses indiquées sur la page principale.
Merci et bon travail.
Pour le CREDDA
Dr. Kihangi Bindu Kennedy
Le Coordinateur
En collaboration avec l’Association « Objectif Brousse », le Centre de Recherche sur la Démocratie et le Développement en Afrique, CREDDA en sigle, a organisé une Conférence Débats à la Faculté de Droit de l’Université Libre des Pays des Grands Lacs U.L.P.G.L.
Thème : « Pourquoi faut- il protéger le Parc
National des Virunga ? »
Projection d’un documentaire.
Date : Mercredi, le 14 Janvier 2009
Orateur : Mr. Xavier Gilibert (Président de
Objectif Brousse)
Depuis plus d’une décennie, on assiste à l’Est de la République Démocratique du Congo à une destruction méchante de la faune et de la flore due à la guerre. Le Parc National des Virunga, situé dans la province du Nord Kivu, est devenu le lieu de prédilection des activités des milices armées opérant dans la région. Aussi il serait indiqué que la Communauté Internationale, le Gouvernement Congolais, les Etats dont certaines milices sont originaires ainsi que les ONGs tant nationales qu’internationales puissent prendre conscience de ce désastre et œuvrer ensemble pour sauvegarder ce site touristique en voie de disparition. Il est incontestable que la paix et la sécurité dans la région constituent la condition sine qua non de la réhabilitation et la reprise des activités dans le Parc National des Virunga. L’implication du Gouvernement Congolais, les ONGs à vocation environnementales et la population concernée dans la gestion du parc est une nécessité. Sensibiliser et éduquer la population sur l’importance de ce site est d’une importance capitale.
En effet, le Parc National des Virunga est une entreprise vitale pour la relance de l’économie nationale. Sa gestion rationnelle et efficiente dans un contexte de bonne gouvernance pourrait permettre à l’Etat de réaliser des recettes suffisantes devant émarger au budget national. Ceci constitue donc un défi majeur à relever.
Le Centre de Recherche sur la Démocratie et le Développement en Afrique, CREDDA en sigle, est préoccupé par les problèmes soulevés ci - haut. A titre de contribution, il envisagerait de lancer une campagne de sensibilisation et d’éducation de la population au sujet de la protection du Parc National des Virunga.
CREDDA lance un vibrant appel à toute personne physique ou morale de bonne foi qui souhaiterait prendre part à cette campagne, à apporter sa contribution aussi bien financière que matérielle. Cette action est significative pour sauver ce site, « patrimoine commun de l’humanité ». Les conséquences liées à la dégradation de l’environnement ne connaissent point des frontières. L’humanité dans son ensemble est appelée à pouvoir conjuguer des efforts pour sauvegarder les intérêts des générations présentes et futures.

Mr. Xavier Gilibert, Doctorant Kennedy Kihangi Bindu, Dirceteur de l’école de la Rwindi et un ancien Garde parc.
Sous le haut patronage de la Faculté de Droit de l’Université Libre des Pays des Grands Lacs, ULPGL en sigle, il a été organisée par le Centre de Recherche sur la Démocratie et le Développement en Afrique, CREDDA en sigle, une Conférence portant sur :
Thèmes : «Lecture critique des objectifs de
la Conférence Internationale sur
la Paix, la Sécurité, la Démocratie et
le Développement dans la
Région des Grands Lacs (CIRGL) par
rapport à ceux de la C.E.P.G.L. »
« Quid de la relance de la Communauté
Economique des Pays des Grands Lacs
(C.E.P.G.L.) et son impact sur
l’instauration de la paix dans la
Région des Grands Lacs. »
Date : Jeudi, le 15 Janvier 2009
A la suite des recherches effectuées sur terrain par les étudiants de la Deuxième Année de Licence Droit / option droit public de l’ULPGL, il a été relevé lors des débats qu’il existait des difficultés réelles pour la réalisation des objectifs que la dite CIRGL s’était assignée. Aussi les participants ont fait le constat ci-après :
- la CIRGL, à elle seule, ne pouvait avoir des solutions adéquates aux maux rongeant la République Démocratique du Congo et les autres pays limitrophes ;
- la CIRGL ne contenait-elle pas en elle-même des limites (faiblesses) susceptibles de faire basculer l’espoir suscité ? Qu’est ce qui devait être fait en amont pour lui garantir le succès de sa mission ?
- la CIRGL constitue une organisation de trop aux côtés de la CEPGL. Pourquoi ne pas simplement redynamiser cette dernière en l’adaptant au contexte géographique et en réexaminant ses objectifs et institutions ? Cette organisation est à même de favoriser la stabilité régionale grâce à une politique de bon voisinage.
- L’implication de la Communauté Internationale dans le processus de la restauration et du maintien de la paix et sécurité dans la Région des Grands Lacs, les actions incitatives à la paix durable aussi bien des gouvernants que des populations seraient à cette fin des atouts majeurs.

Conférence présentée par Mlle Baby Wengamulay Furaha, Mr. Marco Mpoyi sous la modération de l’Assistant Philippe Tunamsifu.
L’Assistant Philippe Tunamsifu inscrit ses recherches dans le domaine du Droit International Humanitaire. Marco Mpoyi s’intéresse aux questions relatives aux régimes politiques.
Wengamulay Furaha Baby fait des recherches sur les organisations régionales.
Mouvement massif de déplacement des populations dans la province du Nord Kivu, en République Démocratique du Congo
Travail de terrain effectué conjointement par LandInfo (Centre de Recherche Norvégien) et CREDDA du 12 au 18 Octobre 2008
LandInfo: www.landinfo.no
CREDDA : www.credda.populus.ch
En République Démocratique du Congo, le déclenchement des conflits interethniques et la guerre qui s’en est suivie, ont occasionné un mouvement massif de déplacement des populations de la province du Nord Kivu vers d’autres provinces du pays et même au delà des frontières nationales.
C’est le sentiment d’incertitude, de peur du lendemain et même de frustration, rongeant et animant la population locale, qui est l’un des mobiles qui pousse régulièrement un bon nombre de jeunes gens et familles entières à fuir leurs toits, et pis encore, à envisager l’exil à la recherche d’un futur meilleur. Cependant, la voie de l’exil qui est considérée comme l’une des solutions pour échapper aux effets des conflits et guerres sus visés, s’avère souvent la plus périlleuse. Elle est, en effet, parsemée de beaucoup d’embûches, et du coup, le rêve des exilés se transforme souvent et facilement en cauchemar. Mieux encore, certaines personnes réfugiées se retrouvent dans des camps sans assistance suffisante, attendant le statut auprès du HCR dans le pays d’accueil. D’autre part, la réinstallation tant attendue devient incertaine pour plusieurs jeunes gens et familles entières. Les plus vulnérables envisagent même leur retour au bercail, l’intégration au sein de la nouvelle société d’accueil étant utopique.
Les pays à hospitalité légendaire se sont intéressés au sort des ressortissants de la province du Nord Kivu se trouvant éparpillés sur leurs territoires respectifs. C’est dans cet ordre d’idées, que la Commission Norvégienne / LandInfo a séjourné au Nord Kivu pour des séances de travail avec entre autre CREDDA et différentes organisations locales, internationales ainsi que des chercheurs indépendants. Pendant six jours, des échanges fructueux ont eu lieu dans la ville de Goma entre les membres de la Commission et leurs hôtes. L’occasion faisant le larron, la Commission Norvégienne a visité le camp des déplacés de guerre de Buhimba en vue de s’imprégner de la réalité sur le terrain.
Cette expérience n’a été possible qu’avec le concours de l’ONG Internationale «Norvegian Refugee Council », NRC en sigle, engagée dans l’action humanitaire à l’Est de la République Démocratique du Congo.
En définitive, il a été constaté que les conflits interethniques et la guerre qui s’en est suivie, ont profondément bouleversé le vécu quotidien des femmes, enfants et hommes de la province en détruisant le tissu économique dans cette partie de la République Démocratique du Congo. En effet, la population locale, au fil du temps, devient de plus en plus pauvre et tente désespérément de trouver des voies de sortie. Dieu seul sait …
CREDDA
Doctorant Kennedy Kihangi Bindu
Conférence organisée par le Centre de Recherche sur la Démocratie et le Développement en Afrique, CREDDA en sigle, en partenariat avec le Bureau d’Etudes, d’Observation et de Coordination pour le Développement du Territoire de Walikale, BEDEWA en sigle
Les enfants dans les sites miniers d’exploitation artisanale de Bisie en territoire de Walikale
Territoire de Walikale
Faculté de Droit
Université Libre des Pays des Grands Lacs
U. L. P. G. L – Goma
Par le Coordinateur de CREDDA
Doctorant Kennedy KIHANGI BINDU
- Novembre 2008 -
Introduction
Après des recherches fouillées, effectuées conjointement entre le Centre de Recherche sur la Démocratie et le Développement en Afrique, CREDDA en sigle, et le Bureau d’Etudes, d’Observation et de Coordination pour le Développement du Territoire de Walikale, BEDEWA en sigle, sur la situation des enfants dans les sites miniers d’exploitation artisanale de Bisie à Walikale/Nord-Kivu , une conférence débats a été organisée à la Faculté de Droit de l’Université Libre des Pays des Grands Lacs, ULPGL en sigle. L’objectif de cette séance d’échanges était celui d’attirer l’attention de plus d’un observateur averti et avisé sur la situation particulière d’une catégorie des enfants dont les droits sont presque ignorés et faire des suggestions auprès des instances nationales et internationales intervenant dans le domaine de protection et de promotion des droits de l’enfant.
En effet, la célébration de la journée mondiale de l’enfant par les Nations Unies au cours de ce mois de Novembre reste une occasion de joie et de satisfaction pour une catégorie d’enfants et un cauchemar ou un moment de méditation pour une autre catégorie qui se pose un bon nombre des questions sur le pourquoi de leur existence. Si, pour les enfants qui sont sous d’autres cieux cette journée reste un événement important pour faire entendre leur voix et bénéficier de l’attention des gouvernants, des parents et autres structures sociales tant au niveau interne qu’international, la réalité semble être différente lorsque on se situe sur le continent Africain, particulièrement en Province du Nord-Kivu.
Parmi les éléments les plus vulnérables en province du Nord - Kivu, les enfants sont les premières victimes de toutes les calamités notamment l’extrême pauvreté, l’analphabétisme, la faim, les conflits armés et une exploitation à la fois économique et sexuelle dont témoigne la vente, le trafic et la prostitution de leur personne. Nombreux sont les enfants qui continuent de vivre dans des conditions difficiles. Certains sont en prison, des déplacés, des réfugiés, et d’autres pris en otage dans les carrés miniers et ne peuvent bénéficier d’un niveau de vie satisfaisant.
La peur du lendemain demeure une psychose qui détruit l’enfant congolais et ne le place pas à l’abri de toute tentative d’exploitation. Faisant une simple observation de réalités de notre milieu, on peut aisément se rendre compte que ce sont les enfants qui constituent, en effet, une main d’œuvre à vil prix. L’irresponsabilité gouvernementale et la crise de l’autorité parentale ont accouché le phénomène des enfants communément appelés « Mai – bobo, Kadogo, enfants non accompagnés, enfants de la rue, phénomène Kuluna, enfants Shege ». Même si une catégorie semble s’en réclamer, nul n’aimerait à ce que un de ses fils ou filles en fasse partie, en principe. Car certains parents se servent de ces enfants comme « fonds de commerce ». Non seulement le phénomène « Kadogo » a fait et continue à faire de recettes depuis plus d’une décennie, la présence des enfants dans les milieux des seigneurs de guerre reste encore une réalité. Les motifs économiques inavoués des seigneurs de guerre, tel que cela a été démontré dans le cadre d’une étude qui a été faite sur le « téléphone du sang au Kivu », les enfants évoluent non seulement dans les rangs des armées mais aussi les opérateurs miniers ont trouvé en eux une main d’œuvre à bon prix.
La présence des enfants dans différents sites miniers d’exploitation artisanale est une réalité qui doit interpeller plus d’un observateur averti à l’instar des enfants militaires. Curieux de savoir le sort des enfants se trouvant dans les milieux reculés de la province, plus particulièrement dans les mines pour enfin interroger le niveau de mise en œuvre des instruments juridiques portant sur la protection des droits de l’enfant en République Démocratique du Congo, la crème intellectuelle de Goma ainsi que différents représentants des ONGs tant nationale qu’internationale ont répondu massivement à ce rendez vous intellectuel de CREDDA.
Il est bien évident que l’état dans lequel se trouvent les enfants est un baromètre très sensible des effets de changements sociaux et économiques, et ses répercussions sont particulièrement dévastatrices dans les situations des conflits armés.
Partant du thème central intitulé « Les enfants dans les sites miniers d’exploitation artisanale de Bisie à Walikale », trois sous thèmes ont été développés au cours de la conférence, à savoir :
- « l’état de lieux de la législation internationale sur les droits de l’enfant » ;
- « l’état de lieux de la législation Congolaise sur les droits de l’enfant » ;
- « la situation des enfants dans les sites miniers d’exploitation artisanale de Bisie à Walikale ».
Les droits de l’enfant font l’objet des différents instruments juridiques internationaux auxquels la République Démocratique du Congo (RDC) est partie. Partageant le souci de protection et de développement harmonieux de l’enfant, les parties à la Convention Relative aux droits de l’enfant avaient convenus qu’un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Le Code de la Famille tout comme la Constitution, en République Démocratique du Congo, ne donnent pas en détail et clairement lesquels des droits de l’enfant doivent bénéficier d’une protection. La constitution dans son préambule, réaffirme son adhésion et son attachement à la Convention sur les droits de l’enfant. Aux termes de l’article 215 de la Constitution « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie. » Cette disposition a pour conséquence, l’application immédiate sur le plan interne d’une convention ou traité par le juge chargé d’instruire une affaire. L’enfance est ainsi censée rimer avec bonheur, amour et protection, innocence, jeu et apprentissage.
Il importe de préciser de prime à bord que c’est seulement pour des raisons tout à fait évidentes de pauvreté en famille, le manque des structures éducatives appropriées ou mieux le coût exorbitant de scolarisation que les enfants sont obligés à faire des travaux très dangereux qui constituent pourtant l’une des violations des droits de l’enfant. Les enfants victimes de ces tristes réalités errent dans la ville en quête d’un emploi moins ou mal payant pour leur propre survie, au lieu d’être à l’école pendant la journée. Ces derniers sont ainsi abandonnés à leur triste sort et exposés à toutes sortes de sollicitation pour des raisons de survie. Tel est le cas le cas des enfants vendeurs des produits cosmétiques dans la ville de Goma, des enfants considérés comme « baby sisters », garde d’enfants ou mieux domestiques, et les autres qui quittent la ville et rejoignent les sites miniers avec autant des risques dans ces milieux très corrompus ou leur enrôlement dans les rangs des milices armées en province.
Un bon nombre d’enfants se trouvent dans les sites miniers d’exploitation artisanale de Bisie. Ces derniers sont soumis à des travaux très pénibles et risquent leur vie tous les jours . Etant très petits et facilement manipulables, ils sont poussés à descendre dans des tunnels d’exploitation artisanale où ils passent des longues heures à frapper la roche, évacuer l’eau et à circuler dans les galeries de 60 à 100 mètres de profondeur transportant des lourdes charges de 30 à 50 kilos de cassitérite sur leur tête ou sur leur dos.
Dans l’exécution de leur tâche intolérable, les pauvres enfants portent des charges très lourdes pour leur corps et endossent des responsabilités écrasantes compte tenu de leur âge.
Les enfants sont plus vulnérables lorsqu’ils participent aux opérations d’extraction, lorsqu’ils inhalent des poussières et des particules dangereuses et lorsqu’ils utilisent des outils et instruments lourds et surdimensionnés conçus pour les adultes. Vu que ce secteur d’activité en province du Nord Kivu se caractérise par un faible niveau technologique avec des systèmes de sécurité peu présent, un manque de contrôle des conditions sanitaires, les exploitants font recours aux « moyens de bord » et ainsi sont exposés avec leurs employés à toute sorte de maladies. Les enfants exploités sont obligés à faire tous leurs besoins dans des tunnels où ils travaillent. Certes, les conséquences de ce travail sur la santé des enfants et leur épanouissement sont multiples.
Après une présentation du Centre de Recherche sur la Démocratie et le Développement en Afrique, CREDDA en sigle, par le Professeur Jules Kamabu Vangi – si – Vavi, trois sous thèmes tirés du thème central « Les enfants dans les sites miniers d’exploitation artisanale de Bisie à Walikale », ont été développés respectivement par le Professeur Jeanine Kewang à Nwal, l’Assistant Philippe Tunamusifu et Mr. Prince Kihangi Kyamwami, Secrétaire Général de BEDEWA sous la modération du Doctorant Kennedy Kihangi Bindu, Coordinateur de CREDDA.

I. Présentation du Centre de Recherche sur la Démocratie et le Développement en Afrique
Par le Professeur Jules Kamabu Vangi – si - Vavi
Un enfant vient de naître à la Faculté de Droit de l’Université Libre des Pays des Grands lacs, U.L.P.G.L en sigle. Cet enfant porte le nom de CREDDA (Centre de Recherche sur la Démocratie et le Développement en Afrique). Comme vous le savez, le nom qu’on donne à un enfant reflète l’histoire de ses parents. Cet enfant qui vient de naître reflète tout un programme que se fixe la Faculté de Droit de l’U.L.P.G.L., contribuer à la réflexion.
CREDDA est un enfant qui est né dans un contexte de trauma. L’on constate que les sociétés Africaines connaissent des dynamiques en leur sein d’une part, des crises multiformes et qu’il y aurait peu d’intellectuels qui s’intéressent à toutes ces dynamiques et crises d’autre part. Loin d’être afro - pessimiste, CREDDA se veut rassurant que toutes ces dynamiques et crises que connaît l’Afrique en général et le Congo (RDC) en particulier peuvent être transformées en énergie, des actions canalisées dans une réflexion devant relancer le processus de développement et de démocratie.
C’est fort de cette conviction que CREDDA se veut un espace de réflexion d’analyse de situation en vue des actions transformatrices de nos sociétés. Nul n’ignore que tout développement passe par la réflexion, par l’analyse. Ainsi, CREDDA voudrait ouvrir un espace à l’élite, à l’universitaire pour contribuer, tant soit peu, à la réflexion, à l’éducation, à la formation et à l’information qui déboucheraient sur des actions transformatrices à poser.
Au travers de ce qui vient d’être dit se profile la devise de CREDDA : la « Recherche – Action ». Vous comprendrez donc que CREDDA veut changer l’approche de la réalité dans la mesure où on est habitué aux beaux discours mais fort malheureusement qui n’arrivent pas à s’incarner dans les actions concrètes. CREDDA veut se désolidariser de cette rationalité de la mise en exergue du verbe. Au sein du CREDDA, il y a la réflexion et l’action comme pour dire que toute situation incite à la réflexion, la réflexion engendre l’action et l’action demande un suivi. CREDDA s’inscrit dans cette nouvelle rationalité.
Dans sa réflexion et son action, CREDDA se préoccupera de questions relatives :
- à l’éducation, l’information et la formation sur la bonne gouvernance, le leadership et le développement ;
- à la protection et à la promotion des droits et libertés fondamentaux de la personne ;
- à la promotion de droits de la femme et de l’enfant ;
- à la conservation et à la protection de l’environnement en vue d’un développement durable ;
- aux conflits et à la transformation de conflits en vue de la réconciliation et de la paix.
Vaste programme, certes, qui reflète la configuration du Centre. CREDDA est donc un centre pluridisciplinaire.
Voilà en bref ce qu’est votre Centre. Pour en savoir plus sur cet enfant qui vient de naître à la Faculté, il y a un dépliant que vous pouvez obtenir gratuitement auprès de membres qui sont les enseignants de la Faculté de Droit.
II. Etat des lieux de la législation internationale sur les droits de l’enfant

Par le Pofesseur Jeanine Kewang à Nwal
La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par l’Assemblée Générale des NU par sa résolution 44/25 du 20 Novembre 1989.
L’adoption de la Convention clôturait un processus qui avait débuté par les travaux préparatoires de l’année internationale de l’enfant. C’est en effet cette année là, en 1979, que s’est engagé un débat sur un projet de convention soumis par le Gouvernement Polonais. Ce n’était pas la première fois que la communauté internationale se préoccupait des enfants. La Société des Nations en 1924, l’ONU, en 1959, avait adopté des déclarations sur les droits de l’enfant. De même, des dispositions visant expressément les enfants avaient été incorporées dans plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme ou au droit humanitaire. Il n’en demeurait pas moins que plusieurs Etats plaidaient pour l’élaboration d’un texte dans lequel les droits des enfants seraient énoncés dans les détails, texte qui aurait force obligatoire au regard du droit international. Cette idée s’expliquait par les graves injustices dont les enfants étaient victimes : taux de mortalité infantile élevé, soins de santé déficient, chances réduites d’accéder à une instruction élémentaire. A ces injustices venaient s’ajouter des situations alarmantes : enfants mal traités et exploités aux fins de la prostitution ou des travaux dangereux, enfants emprisonnés ou placés dans d’autres situations difficiles, enfants réfugiés et victimes des conflits armés. L’élaboration de la convention s’est faite au sein d’un groupe de travail créé par la commission des droits de l’homme des NU, dont le noyau était constitué des représentants des gouvernements ; mais des représentants d’organes et d’institutions spécialisées des NU, dont le Haut Commissariat des NU pour les Réfugiés (HCR), l’OIT, Organisation des NU pour l’Enfance UNICEF, et l’OMS, ainsi que d’un certain nombre d’organisations non gouvernementales ont aussi pris part aux délibérations. Le projet original soumis par le gouvernement polonais a été largement modifié et étoffé au cours des longues discussions auxquelles il a donné lieu. L’adoption, à l’unanimité, de la convention par l’AG des NU a ouvert la voie à l’étape suivante : la ratification de la convention par les Etats et l’instauration d’un comité de suivi. En moins d’un an, en septembre 1990, vingt Etats avaient ratifié la convention qui est alors entrée en vigueur. Le même mois, sur l’initiative de l’UNICEF et de six pays (Canada, Egypte, Mali, Mexique, Pakistan et Suède), s’est tenu à New York le sommet mondial pour les enfants. Le sommet a encouragé les Etats à ratifier la convention. A la fin de 1990, 57 Etats l’avaient fait, devenant de ce fait parties à la convention. En 1993, la conférence mondiale sur les droits de l’homme, qui s’est tenue à Vienne, a déclaré que le but à atteindre était d’obtenir la ratification de la convention par tous les Etats avant la fin de 1995. Or, au 31 Décembre 1995, pas moins de 185 pays, nombre sans précédent pour un instrument ressortissant au domaine des droits de l’homme, l’avaient effectivement ratifié.
De ce qui précède, il est important de voir le principe universel et tourner vers l’avenir : la convention relative aux droits de l’enfant revêt la même signification pour tous les habitants de la planète. Elle énonce des normes communes, tout en prenant en considération les différentes réalités culturelles, sociales, économiques et politiques des Etats pris individuellement, de sorte que chaque Etat peut chercher à mettre en œuvre, selon ses propres moyens, les droits communs à tous. La convention consacre quatre grands principes qui visent à faciliter l’interprétation de la convention dans son ensemble et, partant, à orienter les programmes nationaux de mise en œuvre. Ces grands principes sont formulés dans les articles 2, 3, 6 et 12.
- l’article 2 porte sur la non discrimination ;
- l’article 3 porte sur l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- l’article 6 sur les droits à la vie et au développement ;
- l’article 12 sur l’opinion de l’enfant.
Il y a eu un suivi constructif :
Des organes internationaux de défense des droits de l’homme contribuent, dans leurs propres domaines de compétence, à améliorer le respect des droits de l’enfant. Outre la commission des droits de l’homme, la sous commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection de minorité et son groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage (qui s’occupe des questions liées à l’exploitation et au mauvais traitement dont sont victimes les enfants), il existe des organes suivants :
- le comité des droits de l’homme ;
- le comité des droits économiques, sociaux et culturels ;
- le comité pour l’élimination de la discrimination raciale ;
- le comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard de la femme ;
- le comité contre la torture.
Cinq comités sont couramment désignés sous le nom d’organes conventionnels, puisque ils ont été créés pour suivre l’application de tel ou tel instrument des NU relatif aux droits de l’homme par des Etats qui ont ratifié le dit instrument ou y ont adhéré. La création du comité des droits de l’enfant en vertu de l’article 43 de la convention est venu renforcé l’activité des ces organes en faveur des enfants.
Comité des droits de l’enfant
Au début de 1991, les représentants des Etats parties à la convention ont été convoqués pour élire les premiers membres de l’organe qui serait chargé de suivre l’application : le comité des droits de l’enfant. Une quarantaine des candidatures ont été présentées pour 10 sièges à pourvoir. Les experts, dont six femmes, élues à cette occasion étaient originaires de la Barbade, du Brésil, du Burkina-Faso, de l’Egypte, du Pérou, de philippines, de la Suède, de l’ex URSS et de Zimbabwe. Leur expérience professionnelle allait des droits de l’homme et du droit international à la justice pour mineur, en passant par des affaires sociales, la médecine, le journalisme, l’administration et l’activité non gouvernementale.
Le comité des droits de l’enfant tient actuellement trois sessions par an, d’une durée chacune de 4 semaines. La dernière semaine est toujours réservée à la préparation de la session suivante. Le comité est desservi par le haut commissaire des NU/centre pour les droits de l’homme à Genève.
Selon l’article 44 de la convention, les Etats parties s’engagent à soumettre régulièrement au comité des apports sur les mesures prises pour mettre la convention en application et sur le progrès réalisé dams l’exercice des droits de l’enfant sur leur territoire. Les premiers rapports doivent être soumis dans les 2 ans à compter de la ratification de la convention ou de l’adhésion à celle-ci, le suivant tous les cinq ans. Les premiers rapports initiaux étaient attendus en septembre 1992. En Décembre 1995, plus de 70 Etats avaient adressé leur rapport au comité.
A sa première session, en Octobre 1991, le comité a adopté des directives pour aider les Etats parties de la présentation et la rédaction de leur rapport initial. Il recommande aux gouvernements d’établir leur rapport en se conformant à ses directives, qui soulignent que le rapport doit indiquer « les facteurs et les difficultés » auxquels l’Etat se heurte dans la mise en œuvre de la convention, en d’autres termes, que le gouvernement devrait rappeler l’attention sur les problèmes et pratiquer l’auto - critique. Le comité demande par ailleurs aux Etats de préciser quels sont « les priorités et les objectifs spécifiques » pour l’avenir. Il invite les Etats à joindre à leur rapport les textes des lois et des données statistiques pertinentes. En mettant au point ces méthodes de travail, le comité a insisté sur l’importance qu’il y avait à engager un dialogue constructif avec les représentants des gouvernements. A ce propos, il a ajouté qu’il cherchait à collaborer étroitement avec les organes et les institutions spécialisées compétentes des NU, ainsi que avec les autres organismes intéressés, dont les organisations non gouvernementales.
Le kit d’information « enfant dans la guerre » existe en français, anglais, espagnole, et en arabe. Son contenu vise à mieux faire comprendre les activités du CICR concernant les enfants. Le kit contient des fiches techniques qui sont mises à jour chaque année.
Contenu du Kit
1. article de base « les enfants la guerre », juin 2001 (mis à jour 2003) : offre un aperçu général de la problématique et des activités légales et opérationnelles du CICR et avec les mouvements (paru dans la revue internationale de Juin 2001, Vol 83, no 842).
2. fiche juridique : « la protection juridique des enfants dans les conflits armés » (mis à jour 2003).
3. tableau de droit international humanitaire : tableau de synthèse des dispositions du DIH spécifiquement applicable aux enfants (mis à jour 2003).
4. fiche protection : « qu’est ce que la protection le CICR » (mis à jour 2003).
5. fiche assistance : « l’assistance aux enfants dans la guerre (mis à jour 2003).
6. fiche diffusion DIH : « programme de communication destiné à la jeunesse » (mis à jour 2003).
7. fiche diffusion mines : « les enfants et les programmes de prévention contre les dangers des mines et des munitions non explosées (mis à jour 2003).
8. fiche diffusion aux forces armées : « document de travail pour les délégués auprès des forces armées et de sécurité concernant la protection des enfants dans les situations de conflit armé et trouble » (mis à jour 2003).
9. « le plan d’action du mouvement » conseil des délégués, 1995 : « enfant touché par les conflits armés (résumé).
10. résolution 8 « enfant touché par les conflits armés et résolution » 9 « les enfants de la rue », conseil des délégués en 1999.
Les soins de santé maternelle et infantile
Dans plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Europe Orientale, le CICR mène des programmes de santé fondés sur les principes de la stratégie des soins de santé primaire. Ce faisant, il contribue à maintenir et, au besoin, à rétablir l’accès aux soins de santé pour les populations locales isolées ou déplacées par un conflit. En tant que groupe particulièrement vulnérable, les mères et leurs enfants retiennent bien évidemment toute l’attention dans le cadre des activités dites de santé maternelle et infantile à savoir :
- programme élargi de vaccination,
- surveillance de la croissance,
- partenariat avec l’OMS dans le cadre de la campagne pour l’éradication de la poliomyélite,
- lutte contre la maladie transmissible,
- surveillance de la grossesse et soins ante natals et post natals,
- éducation à la santé en collaboration avec les enseignants,
- Orientation des enfants vers des hôpitaux en cas de besoin,
- Formation du personnel local au traitement des maladies de l’enfant (gestion intégrée des maladies de l’enfant).
En 2001, au Sud Soudan :
- vingt mille vaccinations d’enfants de moins de cinq ans ont été effectuées dans une population estimée à 34 000 enfants,
- 8 172 ont été vaccinés contre la poliomyélite durant la campagne nationale d’éradication de la maladie,
- 7 150 consultations pré natales ont été données dans une population estimée à 34 mille femmes.
Le DIH accorde une protection étendue à l’enfant. En cas de conflit armé, qu’il soit international ou non international, l’enfant bénéficie de la protection générale accordée aux personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités. A ce titre, un traitement humain lui est garanti et les règles du DIH relative à la conduite des hostilités lui sont applicables. Etant donné la vulnérabilité particulière de l’enfant, les conventions de Genève de 1949 (CG III et IV) et leurs protocoles additionnels 1977 (PA 1 et 2) prévoient en sa faveur un régime de protection spéciale. Enfin, l’enfant qui prend directement part aux hostilités ne perd pas cette protection spéciale. Aussi, la Convention de 1989 relatifs aux droits de l’enfant ainsi que son récent protocole facultatif, notamment, fiche les limites à sa participation aux hostilités.
III. Etats de lieux de la législation Congolaise sur les droits de l’enfant
Par l’Assistant Philippe Tunamusifu
Lorsque le coordinateur du CREDDA nous a proposé de réfléchir sur « l’état de lieux de la législation congolaise sur les droits de l’enfant », nous n’avons nullement hésité d’y consacrer notre temps.
Lorsque nous avons pensé pour la première fois à l’intitulé de notre communication, nous avons vite renoncé à cette formulation parce qu’il pouvait paraître d’abord restreinte ensuite, sur le plan interne, ces droits ne sont pas clairement définis, c’est pourquoi ils ont une dimension universelle. Nous avons rejeté cette première formulation en optant de faire « un état de lieux sur les droits de l’enfant en RDC». Celui-ci nous paraît plus général étant donné qu’il présuppose l’analyse des instruments juridiques internes et internationaux
Parlez de l’état de lieux revient à nous interroger sur les circonstances que nous traversons. Ainsi, nous nous limitons à deux circonstances majeures car d’une part le monde traverse une crise alimentaire mondiale qui n’épargne la RDC et d’autres part la région des grands lacs africains traverse une instabilité politique et institutionnelle caractérisée par des conflits armés et coups d’Etats depuis 18 ans dont la RDC 12 ans déjà.
La première a pour incidence la hausse de prix des biens de première nécessité sur le marché alors que le salaire ne suit pas et pour la seconde, en ce qui concerne la RDC, la guerre est l’un des facteurs de hausse de prix à cause de rareté des matières étant donné que la production est faible.
Les deux circonstances mettent en branle la situation socio-économique des familles, cadre naturel de la protection de l’enfant.
Que la crise qu’elle soit politique, économique, sécuritaire,… ne laisse indifférent les enfants ; premières victimes. Ces circonstances ont une implication directe sur l’ineffectivité des droits de l’enfant. N’étant l’objet de la présente communication, nous n’allons pas nous y attarder car nous réfléchissons sur l’état de lieux des droits de l’enfant en RDC.
Il est généralement admis que la venue au monde d’un enfant crée une situation morale constituée par l’ensemble des droits qu’acquiert le nouveau-né de par sa naissance, lesquels droits lui sont reconnus par la société. Cette reconnaissance des droits de l’enfant implique ipso facto l’affirmation des devoirs que contractent aussi bien le géniteur que la société par rapport à l’enfant, du moment qu’ils peuvent se considérer comme cause de la venue au monde de cet enfant. Ces droits et devoirs sont circonscrits de façon spécifique selon la mentalité et les façons de faire des peuples envisagés.
En effet, l’enfant, en raison de son immaturité tant physique qu’intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance.
L’humanité doit à l’enfant ce qu’elle a de meilleur à donner et cela s’explique par le fait que nous pouvons voir l’avenir rien que dans la manière dont nous nous occupons de nos enfants ou des enfants aujourd’hui.
Ce que le monde veut pour les enfants, nous le trouvons dans les instruments juridiques internes et internationaux relatifs aux droits de l’enfant où sont exprimés le plus clairement leurs droits. Sur le plan interne, nous avons le Code de la famille du 1er août 1987 et la Constitution du 18 février 2008 alors que sur le plan international nous avons la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 à laquelle on peut ajouter la IVe Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949.
III. 1 Sur le plan interne
La législation congolaise assimile l’enfant au mineur sous la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics. Ainsi, le Code de la famille prévoit à son article 219 que « le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de 18 ans accomplis ». Ce que réaffirme la Constitution lorsqu’elle dispose à son article 41 que « l’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus ; (al1). Tous les enfants, précise l’art 645 du Code de la famille, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs père et mère. Ces derniers, souligne l’art 648, ont l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Toutefois, la Constitution prévient que l’abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie, les abus sexuels ainsi que l’accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi. Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d’assurer leur protection contre tout acte de violence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer (art 41, al4-5).
Au chapitre des enfants en conflit avec la loi, communément appelé enfants délinquants, le Décret du 6 décembre 1950 sur l’enfance délinquante institue un système pénal et procédural particulier caractérisé par la prédominance des mesures de garde, d’éducation et des préservations sur les sanctions proprement dites. Ce Décret fut modifié par l’Ordonnance Loi n° 78/16 du 14 juillet 1978 portant sur l’enfance délinquante qui accorde un large pouvoir au juge quant à ce ; soit de laissez l’enfant chez ses parents ou chez les particuliers qui en ont la garde, soit le soustraire à son milieu et le confier provisoirement à un particulier, à une société ou à une institution de charité public ou privé.
Le Code de la famille tout comme la Constitution ne préconisent pas en détail et clairement lesquels des droits de l’enfant doivent protection. La Constitution, dans son préambule, réaffirme son adhésion et son attachement à la Convention sur les droits de l’enfant. C’est pourquoi l’art 215 dispose que « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ». Cette disposition a pour conséquence, l’application immédiate sur le plan interne d’une convention ou traité par le juge qui doit instruire l’affaire.
III. 2 Sur le plan international
Les droits de l’enfant possèdent une longue histoire dont nous vous dispensons la chronologie. Notre thématique se focalisera surtout aux Conventions précitées.
Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière, tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant et reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement ; les Etats parties à la Convention relative aux droits de l’enfant ont convenus qu’ « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable » ; art 1.
La RDC a signée ladite Convention en date du 20 mars 1990, elle a reçu l’instrument de ratification le 27 septembre et entrée en vigueur en date du 27 octobre de la même année.
Toutes les sociétés espèrent que leurs enfants grandiront et deviendront des citoyens capables et responsables qui contribueront au bien être de leur communauté. Le principe est que la vie et le développement normal de l’enfant devraient recevoir une priorité absolue dans les préoccupations et les moyens de la société et que les enfants devraient pouvoir compter sur cet engagement dans son évolution.
De part la naissance, tout enfant doit être protégé dès que son existence est confirmée et surtout s’il est né vivant et viable. Ainsi, l’enfant a droit à la vie (ar.t 6), droit à un nom et à une nationalité (art. 7), droit aux parents car c’est ici où l’on affirme que tout enfant est supposé avoir pour père le mari de sa mère (art. 5), droit à l’éducation de base, droit aux soins médicaux, droit à la protection de l’enfant privé de son milieu familial, droit au développement,…
Dans son évolution, l’enfant a droit d’exprimer son opinion et d’être écouté (art. 12), droit à l’instruction scolaire (art. 28) dont la Constitution consacre la gratuité de l’enseignement primaire en le rendant même obligatoire (art. 43, al.4), droit à la protection contre la discrimination de race, de sexe, de couleur, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, droit à la protection contre les mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle et la négligence (art. 19), droit aux vacances c'est-à-dire au repos et aux loisirs (art. 31), droit à l’argent de poche (art. 27), …
La protection et le respect des droits de l’enfant étant une obligation capitale, elle ne sera pas seulement de mise en période de paix, mais aussi en période de guerre. La majorité des enfants qu’emportent les guerres ne meurent pas seulement sous les bombes ou par balles ; mais aussi de froid, de faim ou de maladie.
C’est pourquoi, le premier protocole additionnel et la IVe Convention de Genève sont unanime que les enfants feront l’objet d’un respect particulier et seront protégés contre toute forme d’attentat à la pudeur. Ils recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison. Toutes mesures possibles dans la pratique seront prises pour que les enfants de moins de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités et, s’ils sont devenus orphelins ou sont séparés de leur famille du fait de la guerre, pour qu’ils ne soient pas laissés à eux-mêmes et que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation. En cas d’arrestation, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu’unités familiales. Une condamnation à mort ne sera pas exécutée contre les personnes qui n’avaient pas 18 ans au moment de l’infraction.
A moins de raisons impérieuses, aucune partie au conflit ne procédera à l’évacuation, vers un pays étranger, d’enfants autres que ses propres ressortissants. Lorsque l’évacuation a lieu, toutes mesures seront prises pour faciliter le retour des enfants dans leur famille et dans leur pays.
III. 3 Les instruments juridiques à l’épreuve du terrain
L’enfance est censée rimer avec bonheur, amour et protection, innocence, jeu et apprentissage. Avec la prévalence des conflits armés dans le monde, l’exploitation des enfants pendant la guerre au sein des forces armées ou groupes armés n’est plus à démontrer. L’enfant s’engage ainsi pour des raisons diverses :
Des raisons économiques : l’enfant s’engage pour pouvoir vivre dans des meilleures conditions. Il est ainsi incité s’il a connaissance des avantages financiers qu’il peut en retirer et n’hésite pas lorsqu’il ne dispose d’aucune autre possibilité de survie ; En plus, la présence des enfants dans la rue, l’exploitation sexuelle des mineurs sont autant d’éléments qui le prouve ;
Des raisons liées à la sécurité physique de l’enfant : les enfants qui ont été témoins de meurtres ou de massacres sont plus enclins à rejoindre les forces ou groupes armés au sein desquels ils pensent être plus en sécurité face aux dangers existants ;
Des raisons liées à la culture ou à l’environnement : l’enfant s’engage dans la vie militaire car considérée comme moyen de s’élever et d’obtenir une certaine gloire ou encore suite à une pression d’amis déjà recrutés ; ne dit-on pas que l’environnement corrompt les mœurs ?;
Des raisons psychologiques et sociales : la séparation de l’enfant d’avec ses parents soit par décès, divorce ou disparition. Il peut s’agir aussi du désir de vengeance ;…..
Des raisons de pauvreté des familles au niveau de revenu et d’insatisfaction des besoins fondamentaux des enfants, le manque de structures éducatives ou mieux le coût exorbitant de la scolarisation : occasionnent le travail même dangereux des enfants pourtant l’une des violations les plus graves des droits des enfants dans le monde aujourd’hui. Les enfants victimes de ces tristes réalités circulent ici et là de grandes distances à pieds en quête de petit travail moins payant pour leur propre survie, au lieu d’être à l’école la journée. C’est le cas des enfants vendeurs des produits ici dans la ville de Goma, comme « baby sisters » ou garde d’enfants ou mieux domestiques, des enfants dans les sites miniers avec autant de risques que cela présente.
Le travail des enfants est un résultat d’une politique qui prive les parents travaillant dans les entreprises publiques de l’Etat de leur salaire et pourtant la Constitution tout en garantissant le droit au travail préconise que la rémunération doit être équitable et satisfaisante (art 36. al2). Les enfants qui sont dépendants des revenus du père ou de la mère sont les premières victimes. Ces natures de privation des ressources aux parents exposent aussi les enfants à la mendicité ou à faire un travail informel.
Aujourd’hui, la protection des mineurs privés de liberté, pour tant garantis par les instruments juridiques, reste plus une théorie. Le milieu carcéral est devenu le dernier recours en cas d’infraction aux lois pénales et même si la détention s’avère nécessaire, elle doit être aussi brève que possible et s’effectuer de préférence en milieu non carcéral. A la prison centrale de Goma, les enfants délinquants sont internés dans les mêmes conditions et ensemble avec les adultes voir les délinquants d’habitude, récidivistes et ceux ayant une tendance persistante vers la criminalité. Cela entraîne comme conséquence : le mineur délinquant est quotidiennement entraîné à la prison et acquièrent des nouvelles techniques criminogènes. A la sortie de la prison, la plupart des enfants ne sont plus éducables à cause de mauvais traitements qui leur ont été infligés par les délinquants redoutables avec lesquels ils sont mêlés.
En définitive, nous avons accepté de faire cet état de lieux, bien que sommairement, car la protection de l’enfant est un droit pour tout enfant, un droit fondamental et plus précisément un droit naturel qui se fonde sur les exigences de la nature humaine de demain.
Dans nos sociétés actuelles, nous constatons avec amertume que les enfants ne sont pas protégés suffisamment contre la faim, contre les maladies, contre l’ignorance, le mauvais traitement, contre la guerre, l’irresponsabilité et contre la mort prématurée.
Ce constat malheureux est un reflet fidèle de la contradiction existentielle réelle à dépasser dans le comportement des adultes africains contemporains à l’égard de l’enfant. Cette contradiction est qu’à la naissance, les parents africains comblent l’enfant d’une affection profonde et dans la suite ils se désintéressent de sa socialisation, de son intégration dans les structures communautaires établies.
Pour que les enfants aient accès et jouissent du droit à l’éducation, surtout les enfants issus des familles modestes et celles qui ont été affaiblis par les pillages, la crise de la guerre et les catastrophes naturelles, nous recommandons au gouvernement d’accroître le budget national destiné à l’éducation et de supprimer la « prime de motivation des enseignants » étant donné que l’enseignement primaire est, selon la Constitution à son art. 43 al.4, obligatoire et gratuit dans les établissements publics. D’instituer des juridictions spéciales pour enfants et que les enfants en conflit avec la loi soient séparés des adultes et d’organiser des programmes de formation et d’apprentissage pour la resocialisation des mineurs en lieux de détention étant donné que le devoir et l’intérêt de la société est de récupérer un délinquant et de faire de lui un citoyen utile plutôt qu’un hors la loi.
IV. La situation des enfants dans les sites miniers d’exploitation artisanale de Bisie à Walikale
Par Mr. Prince Kihangi Kyamwami
IV. 1 Introduction
Quelques décennies après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’ONU a adopté en 1989, à l’unanimité, la Déclaration des droits de l’Enfant. Au sens de cette convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Concernant les enfants travailleurs, cette convention aborde le problème à son article 32 qui stipule : « l’enfant doit être protégé contre l’exploitation économique et n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social ». Ceci veut tout simplement dire que l’on protège les enfants de l’esclavage, des travaux dangereux, et que si l’enfant travail, son travail ne doit pas être trop dur ou mettre sa santé en danger. Il doit être un travail acceptable, c’est-à-dire rentrant dans le cadre de son éducation, qui apporte formation, donne un statut convenable à l’enfant et n’entrave pas son développement intellectuel, physique et psychologique. Cependant, 40 ans sont passés et rares sont les pays qui respectent ces simples droits.
IV. 2 Position du problème
Le travail des enfants dans les mines est une réalité qui concerne aussi le territoire de Walikale. Compte tenu de la richesse de son sous-sol, le territoire de Walikale est fortement touché par cette activité dure et éprouvant pour les enfants à qui l’on demande les mêmes efforts qu’aux adultes. Ils sont nombreux à s’échiner dans les mines et carrières de Mundgjuli, Irameso, Rwasombe, Bilobilo et Bisie pour ne citer que ça.
Avec beaucoup d’amertumes, certes, on remarque que plusieurs dizaines de jeunes enfants dont l’âge varie entre 10 et 17 ans risquent leur vie tous les jours, travaillent dans des conditions inhumaines en accomplissant des tâches considérées comme les pires formes de travail dangereux. Et, plusieurs dizaines d’autres seraient sur le point de rejoindre cette activité dangereuse et interdite pourtant par les instances internationales.
Les enfants sont nombreux dans les sites miniers d’exploitation artisanale de Bisie. Le caractère dangereux du travail accomplis par ces enfants laisse à désirer à plus d’un égard. Ils sont appelés à creuser des trous dans les collines, à descendre dans les tunnels d’exploitation artisanale entre 60 et 100 mètres de profondeur pour évacuer l’eau et les produits miniers. Jusqu’à ces jours, les différents responsables des carrières et mines artisanales (chefs des puits) ne sont jamais arrivés à se passer du service de ces enfants et, aucun service de l’Administration publique ne s’occupe de cette problématique en territoire de Walikale. Plus préoccupant encore, ce travail a pour effet de pousser un nombre croissant des jeunes vers d’autres formes de travail plus dangereux, intolérables et illicites comme la prostitution et le trafic de la drogue.
Il s’agit d’activités intrinsèquement condamnables qu’il faut à tout prix abolir et les victimes doivent bénéficier de toute urgence d’une protection et en être soustraites. Tous ces enfants n’ont pas la chance d’avoir une véritable enfance, une éducation ou une vie meilleure. Ils sont employés à des travaux nuisibles à leur santé mentale, physique et à leur développement.
IV. 3 Raisons qui poussent les enfants à travailler
Arrachés à l’enfance, les enfants sont de plus en plus exploités. En Territoire de Walikale, ils sont exposés à des crises multiformes notamment les catastrophes naturelles, chocs économiques, pandémie du VIH/SIDA, conflits armés. Les conséquences de ces crises poussent un nombre croissant des jeunes vers des formes de travail insupportable et insoutenable tel la prostitution, le trafic de la drogue etc.
Les enfants comme les parents doivent travailler pour permettre à leur famille de survivre, car le chômage bat son plein ou le salaire que perçoivent les ouvriers et agents de l’Etat sont beaucoup trop bas ou n’existent pas du tout pour qu’une famille puisse vivre sans cet apport. Les moyens disponibles ne répondent pas aux besoins de la famille ;
Le manque d’encadrement de l’activité est une justification valable de la présence des enfants dans les mines en territoire de Walikale en plus de l’ignorance de la part des enfants et de leurs parents des risques encourus.
En effet, la diminution des charges publiques pour la scolarité a entraîné une diminution sensible du nombre d’enfants fréquentant l’école car celle-ci devient trop chère. L’accès à l’éducation est par conséquent une charge difficile à supporter par la famille. Ainsi, les enfants, de gré ou de force, sont arrachés à la protection de leur famille parce que tout simplement ils cherchent à s’instruire eux-mêmes. Aux éléments sus mentionnés, il faut ajouter le manque de prise de conscience de l’importance de la scolarité dans certaines familles ; l’absence de perspectives d’emploi après les études ; l’absence d’écoles et/ou d’enseignants dans cette partie du territoire national ; le manque de tradition familiale d’envoyer les enfants à l’école.
Autant d’autres facteurs qui incitent une grande partie des familles à négliger la scolarisation des enfants pour accepter qu’ils aillent passer leur temps dans les mines. Et même si les familles pouvaient trouver des ressources pour les envoyer à l’école, elles ne considèrent pas la scolarité d’un enfant comme une priorité. En plus, même s’il va à l’école, il sera bien moins suivi par les parents ou les proches. Dans ce cas, il passe moins de temps à l’école et finit par abandonner les études pour tenter sa chance comme des aînés qui, grâce à cette activité ont pu s’acheter un vélo ou une radio.
Il faut également retenir que l’enclavement de ce site est un élément qui influe plus sur la présence de ces enfants dans le site et la difficulté de leur venir en aide. C’est ainsi qu’une Coopérative minière dénommée WALIKALE MINING a pris l’initiative de désenclaver le site.
IV. 4 Conditions de travail
Les conditions de travail dans les mines artisanales sont très pénibles pour les enfants et on n’insistera jamais assez sur l’aspect inhumain des tâches accomplies par les enfants. En effet, les enfants travaillent d’arrache-pied. Ils sont exposés à des risques graves et vivent dans des conditions effroyables. Ils doivent se lever très tôt. C’est à peine qu’ils ont le temps de manger un morceau de pain que les voilà déjà partis pour les mines. Ils travaillent toute la journée dans une chaleur à peine supportable dans des nuages de poussières rouges avec une très faible lumière, des hurlements de nombreux mineurs et les bruits des marteaux, la peur constante d’un éboulement et des percements des poches d’eaux.
Bref, les enfants travaillent dans des conditions très pénibles et risquent leur vie tous les jours. Parce qu’ils sont très petits, ils sont poussés à descendre dans des tunnels d’exploitation artisanale où ils passent des longues heures à frapper la roche, évacuer l’eau et à circuler dans les galeries de 60 à 100 mètres de profondeur transportant des lourdes charges de 30 à 50 kilos de cassitérite sur leur tête ou sur leur dos.
Dans l’exécution de leur tâche intolérable, les pauvres enfants portent des charges très lourdes pour leur corps et endossent des responsabilités écrasantes compte tenu de leur âge.
Les enfants sont plus vulnérables lorsqu’ils participent aux opérations d’extraction, lorsqu’ils inhalent des poussières et des particules dangereuses et lorsqu’ils utilisent des outils et instruments lourds et surdimensionnés conçus pour les adultes. Ce secteur d’activités se caractérise par un faible niveau technologique avec des systèmes de sécurité peu présent, un manque de contrôle des conditions sanitaires. Ils sont obligés à faire tous leurs besoins dans des tunnels où ils travaillent.
Les conséquences de ce travail sur la santé des enfants et leur épanouissement sont multiples.
IV. 5 Les conséquences sur leur santé et leur avenir
Les Conditions pénibles de travail constituent des facteurs de risques favorables à la propagation et la prolifération des maladies dans le site. Les risques d’une détérioration rapide de leur santé sont très importants. Il est à remarquer que des enfants, suite au port des charges trop lourdes ne dépassent pas plus de 4 à 5 ans sans que leur constitution physique ne soit complètement détériorée, la colonne vertébrale définitivement courbée et la capacité thoracique diminuée. L’effondrement des galeries est un danger omniprésent. Diverses maladies sont provoquées par ce travail. Par le fait d’être entassés dans des lieux sombres et pollués des poussières, les yeux et poumons sont abîmés et atteints des maladies.
Pendant leur travail, les enfants risquent de se couper les mains et de contracter le tétanos. Le site est très isolé en brousse et ne dispose d’aucun centre de santé ou du personnel médical. Les blessés et malades doivent parcourir des longues distances dans des conditions difficiles pour rejoindre un centre des soins. Ainsi, nombreux sont ceux qui meurent de leurs blessures et maladies faute des soins appropriés.
Les maladies chroniques, la consommation de l’alcool, l’usage des stupéfiants, l’escroquerie, le banditisme et même la criminalité sont autant des pratiques auxquelles se livrent les enfants. Ce comportement obère toute chance pour les enfants de devenir un jour des adultes responsables en bonne santé.
Abandonnés et séparés de leurs familles, ces enfants ne sont pas capables de connaître leurs droits, non plus ils ne sont pas préparés à être indépendants et trouver un emploi. A la sortie des mines, peu d’activités les attendent. C’est ainsi qu’ils sont enrôlés de gré ou de force dans l’Armée ou dans des groupes qui luttent contre le gouvernement. Ils sont soldats, rebelles, ils participent aux conflits et à la guerre. Ils doivent eux aussi tuer ou torturer. Qui dira que parmi les délinquants et rebelles d’aujourd’hui on ne trouverait pas des adultes qui ont connu cette situation dans leur enfance ?
Outre les enfants impliqués directement dans l’activité minière, d’autres évoluent dans les villages environnants spontanément créés à proximité du site d’exploitation. Ce sont les vendeurs des petits matériels nécessaires à l’extraction ou de nourriture. A observer comment les activités sexuelles sont intenses à Bisie, il y a lieu de craindre le pire. Un nombre élevé de jeunes filles se livre à des rapports sexuels incontrôlés et sans aucune protection avec plusieurs partenaires pour gagner de l’argent. Elles sont ainsi plus exposées au VIH/SIDA et aux autres maladies sexuellement transmissibles.
IV. 6 Conclusion
En définitive, il convient de remarquer que le travail effectué par les enfants dans les sites miniers d’exploitation artisanale de Bisie en territoire de Walikale est la pire des formes de travail dangereux pour les enfants. C’est un cercle vicieux et, les enfants y sont prisonniers parce qu’on entend d’eux qu’ils partagent le fardeau de la substance de la famille. Les enfants travaillent parce que leur survie et celle de leurs familles en dépendent largement.
Abolir ce travail pour les enfants exige de mieux saisir la nature complexe du problème. Les enfants ne peuvent cesser de travailler dans les mines artisanales de Walikale tant que ne surgissent des solutions palliatives permettant d’assumer les besoins de leurs familles. Les mesures à prendre sont celles qui visent à accroître d’abord les moyens et l’autosuffisance des communautés qui peuplent les zones minières. Nombreuses seront les familles à même de donner à leurs enfants une vie meilleure. Ceux qui quittent les mines auront alors accès à une éducation de qualité avec des réelles perspectives d’emplois à la fin de leur scolarité. C’est là un moyen de rompre le cycle vicieux de la pauvreté qui afflige les communautés.
Les souffrances dont sont victimes les enfants dans les mines artisanales en territoire de Walikale expliquent les raisons qui nous poussent à accorder la priorité à la campagne de prévention et d’éradication du travail infantile à partir de Bisie. Agir de concert avec leurs communautés d’origine serait un atout. Il s’agirait de créer des opportunités d’emplois décents pour les adultes et de donner des meilleures chances d’éducation et de formation aux enfants.
Encadrer l’activité et l’équiper sérieusement est une politique de prévention et de retrait des enfants des mines artisanales en territoire de Walikale.
L’objectif à atteindre est donc de :
- Réduire le nombre d’enfants travaillant et rejoignant les carrés miniers en informant, sensibilisant et appuyant les communautés locales avoisinant afin de réduire leur volonté à envoyer leurs enfants rejoindre le travail dans les mines artisanales ;
- Sortir nombre d’enfants du travail dans les mines artisanales en offrant des alternatives économiques viables et durables aux enfants de plus de 15 ans, en scolarisant les enfants de moins de 15 ans et en renforçant économiquement leurs familles. Ainsi, nous aurons agi sur les contraintes qui poussent les familles et les communautés à envoyer leurs enfants dans les mines. Dans ces conditions, l’espoir pourra être permis.
V. Déroulement de la conférence et formulation de recommandations
Après toutes les présentations, une réaction à chaud de l’auditoire a suivi en ces termes : une telle situation dans laquelle l’enfant Congolais se trouve n’est pas acceptable au cours de ce 21ème Siècle, elle doit être dénoncée avec la dernière énergie ; les étudiants voudraient s’engager à côté de CREDDA et de BEDEWA dans cette action afin d’endiguer ce mal qui ronge la société congolaise ; il faut lutter contre le dysfonctionnement judiciaire qui occasionne l’impunité ; étendre cette recherche sur l’ensemble de la province du Nord – Kivu en visitant tous les sites miniers ; traîner en justice les exploitants miniers se servant des enfants ; établir les responsabilités du Gouvernement Congolais et celle des parents ; associer les étudiants dans les campagnes de sensibilisation ; informer la police spéciale de l’enfance de la gravité de la situation.
Il a été compris que cette question mérite une attention particulière de la part de tous les intervenants dans ce secteur en agissant avant qu’il ne soit trop tard. Les humanitaires devraient désormais se lancer dans une campagne de sensibilisation pour faire sortir ces enfants de ces milieux avant que la situation ne prenne des allures très inquiétantes. Les gouvernement doit désormais prendre ses responsabilités en agissant le plus tôt possible en réglementant et en contrôlant convenablement ce secteur. Car si on pourvoit à la survie de ces derniers en les protégeant contre le mal et l’exploitation dont ils sont victimes, on sera en train de poser les bases d’une société juste que les enfants méritent.
Une projection d’un film sur la vie des enfants dans les sites miniers de Bisie à Walikale a été faite à l’intention des participants. Comme on pouvait s’en rendre compte, ces images ont permis à chaque participant à pouvoir faire une lecture conséquente de la situation combien désastreuse des enfants dans les mines au Kivu.
A la lumière de cette triste réalité, Il importe de signaler qu’au-delà de la question de l’enfant soldat, de l’enfant non accompagné et de l’enfant de la rue ou déplacé, l’enfant se trouvant dans les mines d’exploitation artisanale dans le Kivu est un autre défi à relever.
A ce propos, CREDDA et BEDEWA voudraient initier, avec l’apport de toute personne de bonne foi ou organisation internationale, un projet.
Le projet vise à contribuer à la réduction du nombre d’enfants travaillant dans les mines sur toute l’étendue de la Province du Nord/Kivu. Il poursuit pour ce faire une triple stratégie de prévention du travail d’enfants particulièrement vulnérables, le retrait et réinsertion d’enfants creuseurs des mines, l’implication et la responsabilisation des opérateurs économiques en aval.
Le projet développe une triple stratégie.
D’une part, au travers de ce projet, WALIKALE MINING, une Coopérative minière pourra être renforcé dans sa lutte contre le travail des enfants par la vulgarisation des Code et règlement miniers dans les sites miniers d’exploitation artisanale. D’autre part, CREDDA et BEDEWA seront outillés en matière de plaidoyer sur le travail des enfants. Dans le but d’impliquer socialement les opérateurs économiques, il sera organisé un atelier de réflexion sur les filières économiques et les métiers porteurs en vue d’une réinsertion socio-économique durable des enfants issus du travail minier.
Le projet vise à retirer 5000 enfants des mines et à leur offrir une alternative viable et durable au travail dans la mine. Le modèle de réinsertion qui leur sera proposé tiendra compte de leur âge, des contraintes qui les ont initialement poussés à travailler mais également de leurs aspirations et aptitudes. Ainsi, vers fin 2011, CREDDA en collaboration avec le BEDEWA et WALIKALE MINING, une Coopérative minière auront réinséré scolairement 3000 creuseurs de moins de 16 ans et auront proposé l’apprentissage d’un métier et l’exercice d’une activité professionnelle à 2000 creuseurs de plus de 16 ans.
Les interventions s’articulent autour des axes suivants :
- La sensibilisation des enfants, des familles et des communautés ;
- La réduction du degré de vulnérabilité des communautés par la définition de Plans de Développement Communautaires ;
- La réduction du degré de vulnérabilité des familles des enfants afin de compenser le manque à gagner du travail des enfants dans les mines ;
- La mise en place d’un mécanisme de surveillance communautaire afin de permettre aux communautés de jouer un rôle actif dans la dissuasion du travail des enfants dans les mines ;
Il s’agit ici d’une question bien évidente qui doit interpeller l’ensemble de la communauté tant nationale qu’internationale afin de sauver l’avenir de la nation congolaise. Des recherches plus approfondies doivent être faites en y allouant les moyens conséquents. Le désintéressement de l’acteur Congolais tant politique qu’économique à la question de la recherche demeure un autre mal qui lie et place dans l’isolement la crème intellectuelle congolaise capable de mettre à la disposition de sa société son expertise. Les maigres moyens alloués à la recherche par les gouvernants sont à dénoncer afin de permettre aux têtes pensantes à faire bénéficier le monde de son génie de résolution des crises. L’implication de nos universités au travers d’une action pluridisciplinaire des structures des recherches à l’instar de CREDDA et de BEDEWA dans notre région demeure la clé de voûte pour la résolution de toutes les crises qui ont élu domicile dans cette partie du monde.
VI. Photos des intervenants et participants à la conférence

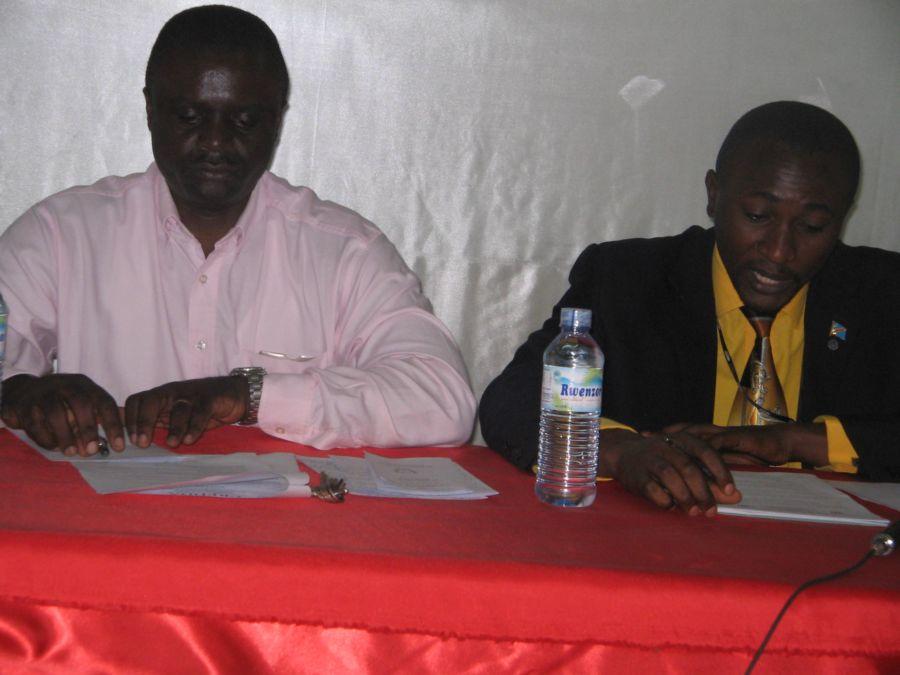



VII. Bibliographie sommaire
1. Constitution de la RDC, In Journal officiel de la RDC, 47e année, numéro spécial du
18 février 2006, Kinshasa, 2006.
2. Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 in Journal officiel de la RDC, 43ème
année, 5 Décembre 2002.
3. Loi n° 87-010 portant Code de la Famille, In Journal officiel de la République du
Zaïre, 28e année, numéro spécial du 1er août 1987, Gbado-lite, 1987 ;
4. CICR, Règles essentielles des conventions de Genève et de leurs protocoles
additionnels, Comprendre le Droit humanitaire, Genève, 1983 ;
5. HCDH, Les droits des enfants : créer une culture des droits de l’homme, cinquantième
anniversaire de la DUDH 1948-1998, Brochure d’information n°3, Nations Unies,
New York et Genève, 1998 ;
6. OCDE, Combattre le travail des enfants : un bilan des politiques, OCDE, Paris, 2003 ;
7. MUNDAY MULOPU MANDY, « la protection de l’enfant : un droit pour l’homme
ntu », In Philosophie et droit de l’homme, Actes de la 5e semaine Philosophique de
Kinshasa de Kinshasa du 26 avril au 1er mai 1981, Faculté de théologie catholique,
Kinshasa, 1982 ;
8. NTUMBA KABELA CICI KOSAKANTE, « Les droits de l’enfant : Essaie de
fondement au niveau de la conception de la famille en milieu bantu », Idem
VIII. Vue Générale de CREDDA
Le Centre de Recherche sur la Démocratie et le Développement en Afrique, CREDDA en sigle, est un cadre de réflexion regroupant l’élite intellectuelle Africaine consciente et avisée du caractère dynamique de la société humaine. L’opportunité est ici offerte aux universitaires à se faire une opinion au travers d’un diagnostic de la crise multidimensionnelle qui sévit sur le continent, dans la Sous Région des Grands Lacs Africains en général, en République Démocratique du Congo pour commencer. Et de développer ainsi les outils nécessaires à une mise en œuvre optimale des bienfaits de la Démocratie et du Développement dans lesquels l’Afrique s’est engagée – avec le reste du monde – pour garantir une heureuse sortie de la servitude.
D’aucuns n’ignorent que la Sous Région des Grands Lacs Africains est le théâtre de conflits politiques et de crises économiques à répétition. Ainsi le CREDDA sert de source d’inspiration et de « back up » aux acteurs socio – politiques. Une courroie de transmission entre la population et ses représentants pourra ainsi être établie en vue de trouver des réponses concrètes aux besoins des citoyens, éclairer les lanternes des uns et des autres, et promouvoir des solutions pratiques aux défis du développement et de la démocratie.
1. Vision
Faire asseoir une culture de la « Recherche – Action » dans les milieux universitaires. Faire de l’université une institution engagée dans une dynamique de progrès et de développement offrant ainsi à la société une élite promise, consciente de son rôle positif et capable de contribuer à construire son environnement en vue du bien être social global. Les conditions de vie difficiles trouveront une explication accompagnée de solutions donnant l’ouverture à une dynamique de croissance économique et de liberté.
2. Mission
Eveiller la conscience de l’universitaire et du citoyen sur ses responsabilités dans la gestion de la chose publique et du développement économique de sa société afin d’assurer son bien être. Car il n’y a point de Liberté sans Responsabilité et point de Développement sans une Transmission organisée du Savoir. L’éducation, l’information et la formation de la population sur la bonne gouvernance politique et économique, le leadership cohésif, l’émergence de la notion d’alternance du pouvoir mais aussi l’auto - prise en charge sont autant d’outils efficaces pour transformer la société.
3. Devise
La « Recherche – Action » est la devise du CREDDA. Le CREDDA croit en une dynamique pluridisciplinaire de recherche approfondie sur les questions liées à la démocratie, la bonne gouvernance et au développement. Des actions concrètes au travers diverses actions de communication sociale, que cela soit dans les salons diplomatiques, les auditoires, les médias, les publications scientifiques ou tous autres moyens de communication, sont les leitmotivs de l’engagement du CREDDA.
4. Motivation
L’ignorance du système normatif sociétal et des faits socio – politiques est un obstacle à l’émergence d’une société démocratique. Nul n’ignore que le respect de la loi et la conformité à celle-ci présuppose la connaissance de ladite loi. Une des pistes offertes pour endiguer ce mal demeure l’engagement et l’implication actif de l’universitaire capable de faire une bonne analyse des problèmes économiques, sociaux, culturels et politiques de notre temps et de répondre aux innombrables défis que lui pose son environnement.
Les institutions universitaires en République Démocratique du Congo et dans la Sous Région des Grands Lacs doivent désormais, comme sous les autres cieux, servir des phares pour éclairer et ainsi former des cadres avisés des défis de la vie collective et capables d’y apporter des solutions adaptées. Les institutions doivent influencer positivement la conduite de la société en mettant à sa disposition un savoir, un savoir - être, et un savoir - faire nécessaire à son développement. Nous pensons que c’est en mettant l’homme au centre des programmes de recherche que la science pourra vaincre l’ignorance, la pauvreté et la violence qui détruisent notre société : «la démarche scientifique, en Afrique aussi, est un outil performant, une force à promouvoir au service de l’humanité ». Tel est le défi à relever par l’intelligentsia aujourd’hui et de demain.
5. Objectifs
- Eduquer, informer et former la population sur la bonne gouvernance, le leadership et le développement ;
- Contribuer à la protection et à la promotion des droits et libertés fondamentaux de la personne;
- Promouvoir les droits de la femme et de l’enfant ;
- Conserver et protéger l’environnement pour assurer le développement durable et la défense des droits des communautés locales dans les carrés miniers, les forêts et les airs protégées ;
- Oeuvrer pour la résolution pacifique des conflits, la réconciliation et la paix ;
- Lutter contre l’impunité;
- Organiser des conférences et séminaires sur des faits socio - politiques et formuler des propositions de solution aux instances de décisions ;
- Publier des articles et ouvrages scientifiques (imprimerie, presses universitaires, site
Web).
6. Domaines d’intervention
- Démocratie et bonne gouvernance ;
- Protection des droits de la femme et de l’enfant ;
- Résolution pacifique des conflits, réconciliation et paix ;
- Protection de l’environnement et développement durable ;
- Consultation et études en appui au programme de développement.
CREDDA demeure certainement une initiative prise par des Professeurs en collaboration avec de jeunes chercheurs - enseignants évoluant dans des institutions universitaires en Afrique des Grands Lacs, Afrique Centrale et Afrique Australe. Son siège est établi en République Démocratique du Congo, à l’Université Libre des Pays des Grands Lacs/Goma.
A ce stade embryonnaire, CREDDA a besoin de la participation de toute personne qui aimerait apporter son savoir, son savoir – faire ainsi que son savoir - être à cette entreprise intellectuelle. D’aucuns notent que la cloche de la tradition orale accompagnée de celle qui est écrite a sonné pour que les sociétés Africaines soient dignement positionnées dans le concert des nations modernes.
Fait à Goma, le 01 Décembre 2008
Par le Coordinateur de CREDDA
Doctorant Kennedy KIHANGI BINDU
|
|